
À partir de Free Jazz/Black Power de Philippe Carles et Jean-Louis Comolli. Cet article a pour suite « On insiste : la liberté maintenant ! » – Partie 21
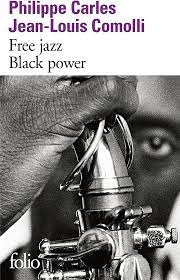
Publié pour la première fois en 1971 (et réédité depuis en 1979 et en 2000 avec à chaque fois l’ajout d’une préface des auteurs), Free Jazz/Black Power de Philippe Carles et Jean-Louis Comolli2 est un texte particulièrement dense, dont les phrases à rallonge, entrecoupées de parenthèses, virgules, notes de bas de pages, etc., pour cerner au plus près leur objet, semblent s’amuser à recréer la polyrythmie du sujet (apparent) du livre, les musiques africaines en Amériques. Aussi âpre à lire que le Free Jazz peut l’être à écouter, il n’en est pas moins indispensable pour quiconque s’intéresse à l’histoire des Africain·es Américain·es ou souhaite réfléchir à la place de la musique, et plus globalement de l’art, dans la société et de son (r)apport à la lutte révolutionnaire.
Les Cahiers d’A2C #09 – SEPTEMBRE 2023
Unité Noire3
Le livre s’inscrit dans la lignée des travaux de LeRoi Jones, et en particulier son livre de 1963, Le peuple du blues4, qui, le premier, entreprend de relire l’histoire du jazz à partir de son point d’aboutissement à l’époque, le free jazz. Ce faisant, il lie cette histoire à celles des luttes des Africain·es Américain·es et met ainsi en lumière le moteur des évolutions du jazz, la lutte entre la récupération et les influences européennes/blanches et l’identité et les influences africaines/noires de cette musique créée par et pour les esclaves.

Nos frenchies entendent se démarquer de Jones sur un point, mais au combien crucial, la question de classe. Ainsi précisent-ils dès l’introduction, « cette contradiction entre valeurs blanches et valeurs noires à l’œuvre dans les colonisations et les résistances à ces colonisations du jazz n’est que l’un des moments de la contradiction principale entre colons et colonisé·es, exploiteurs et exploité·es : le capitalisme et ses proies. » (p.39).
À cette époque où Alger était « la capitale de la Révolution »5, l’anticolonialisme est un marqueur des politiques révolutionnaires. Ainsi, les militant·es révolutionnaires africain·es américain·es qualifient la situation de leur peuple comme relevant du colonialisme (sur exploitation économique, racisme, enfermement dans des ghettos…). Dans une période d’important développement des luttes noires aux USA qui se cristallisent, notent les auteurs, dans le Black Panther Party, toute politique réellement de classe est nécessairement anticoloniale. Et un anticolonialisme conséquent doit prendre en compte la lutte des classes au risque, sinon, de laisser se perpétuer les mécanismes de domination, comme le prouve, hélas, le destin des pays nouvellement indépendants et le développement du néocolonialisme.
Lutter contre la colonisation du jazz par l’esthétique et l’idéologie occidentale implique donc de lutter contre leur relai dans le prolétariat noir, la bourgeoisie et la petite bourgeoisie noire et leur idéologie assimilationniste. « Il est remarquable que l’un des principaux problèmes auxquels sont confronté·es aujourd’hui les militant·es politiques noir·es américain·es soit celui de l’idéologie dominante dans les élites et une partie des masses noires ; qu’ils doivent lutter contre le sentiment de résignation (acceptation de leur « infériorité ») et les illusions de progrès (les choses s’arrangeront quand…) que cette idéologie, celle du capitalisme américain, inculque à ces masses. Et il est non moins remarquable que le free jazz soit apparu comme réaction à la récupération, par la même idéologie, de la musique noire » (p. 43).
Entre les tenants d’un nationalisme culturel (cultural nationalism) dont certain·es se proposent « d’offrir à l’Amérique sa dernière chance de régler raisonnablement ses problèmes raciaux sans s’engager dans une longue lutte de guérilla »6 et les révolutionnaires du Black Panther Party, ou Archie Shepp qui déclare : « notre vengeance sera noire, comme la souffrance est noire, comme Fidel est noir, comme Ho Chi Minh est noir » (cité page 55), les auteurs ont choisi.

Ils sont clairement du côté de Rap Brown, ministre de la Justice du BPP, dont ils citent des propos d’une brulante actualité : « Je prétends que les Noir·es qui ont incendié Watts et Détroit n’ont pas besoin de lire. Ces pauvres gens ont plus vécu que les intellectuels n’ont lu. Ainsi ont-ils un caractère politique à cause de ce que leur a appris l’existence. C’est l’oppression qui fait de ces pauvres gens des politiques.[…]. « L’homme » à crée un nouveau genre de Tom, le bourgeois noir. Ceux-là sont prêts à faire n’importe quoi pourvu qu’ils puissent être noirs avant tout. Des capitalistes noirs, des impérialistes noirs, n’importe quoi pourvu que ce soit noir avant tout. » (p.61)
La France, interdit de séjour le trompettiste Clifford Thornton, coupable d’avoir pris la trompette et la parole lors d’un spectacle de soutien au BPP à Paris en 1970, quelques mois après avoir participé au festival panafricain d’Alger. Les Panthers exilé·es en Algérie, quant à elleux, quitteront le pays s’estimant sacrifié·es sur l’autel de la raison du nouvel État indépendant en recherche de respectabilité internationale.
Cette musique est la nôtre !7
Philippe Carles et Jean-Louis Comolli vont donc s’atteler dans un premier temps à étudier les différentes formes de colonisation que subit le jazz. Car l’appropriation est loin de se limiter à être culturelle. Elle est économique : la bourgeoisie blanche contrôlant l’industrie musicale, c’est elle qui s’enrichit sur l’invention de ses ancien·es esclaves. Cela se traduit aussi par la priorité donnée aux musicien·es blanc·hes pour les enregistrements et les concerts (donc l’accès à des revenus). « Les musicien·es de couleur, dit Lucky Thompson en 1956, se rendent parfaitement compte que, depuis le début du jazz, leur musique a été exploitée de telle sorte qu’ils en retirent le minimum de profit et qu’on leur en retire même le privilège d’en avoir été les créateurs » (p.77).
Cette appropriation économique aura des conséquences sur les formes du jazz : « Voler aux Noir·es leur musique revient à voler les Noir·es à leur musique, à les en refouler » (p.79). En effet, l’industrialisation et la commercialisation du jazz vont avoir comme conséquence le refoulement des éléments africains les plus saillants de cette musique.

C’est alors que rentre en jeu la critique du jazz, c’est-à-dire le discours blanc sur les musiques noires. Elle va raboter le jazz pour le faire rentrer dans la catégorie occidentale « d’art » (catégorie supposée détachée des autres aspects de la vie sociale), c’est-à-dire le couper de ses déterminations sociales et politiques. Pour ensuite s’attacher à édicter les critères de ce qu’est le « vrai » jazz. En effet, depuis l’effroi créé chez les tenants de la tradition swing par Charlie Parker et son be bop, jusqu’à ceux qui considèrent que le « vrais hip hop » est mort avec 2Pac et Biggie ou qui opposent reggae roots et dancehall8, les amateur·es blanc·hes de musique ont toujours été enclins à distribuer des brevets d’authenticité aux formes établies des musiques noires pour mieux dénigrer leurs formes les plus novatrices et/ou populaires.
Analysant le premier roman de LF Céline, le vieux révolutionnaire Léon Trotsky écrit : « Non seulement s’usent les partis au pouvoir, mais également les écoles artistiques. Les procédés de la création s’épuisent et cessent de heurter les sentiments de l’homme : c’est le signe le plus certain que l’école est mûre pour le cimetière des possibilités taries, c’est-à-dire pour l’Académie. La création vivante ne peut aller de l’avant sans se détourner de la tradition officielle, des idées et sentiments canonisés, des images et tournures enduits de la laque de l’habitude. »9

Le bop étant prêt pour l’Académie, adulé par la même critique blanche qui l’avait dénigré, le free jazz allait pouvoir entrer en scène dans un contexte de montée des luttes africaines américaines. Noir et révolutionnaire, comme il se doit ! — On en parle au prochain numéro !
Thomas, Bobigny
NOTES
- Le titre de cet article est un clin d’oeil à We insist ! (Max Roach’s Freedom now suit) – Album de Max Roach (1960) ↩︎
- Philippe Carles et Jean-Louis Comolli, Free Jazz Black Power, Collection Folio. La version actuellement disponible en librairie est identique à celle de 2000 (à l’exception de la couverture) et comprend donc les 2 préfaces et une discographie. ↩︎
- Black Unity – Album de Pharoah Sander (1972).)) et Conscience Universelle ((Universal Consciousness – Album d’Alice Coltrane (1971). ↩︎
- LeRoi Jones, Le peuple du blues, Collection Folio. ↩︎
- Voir la recension du livre de Elaine Mokhefti, Alger capitale de la Révolution ↩︎
- Voir Le Black Power de Stokely Carmichael et Charles V Hamilton, publié en France par Payot en avril 1968. ↩︎
- This is our music – Album de Ornette Colman (1961) ↩︎
- Voir Une histoire politique du Sound System ↩︎
- Léon Trosky, Céline et Poincaré, mai 1933 : https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/litterature/lt19330510.htm ↩︎





