
Les Cahiers d’A2C #14 – Septembre 2024
« Il y a bien une guerre des classes, mais c’est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner. » C’est en ces termes, qu’en 2005, lors d’une interview à CNN, Warren Buffet, un des hommes les plus riches du monde s’est exprimé.
Cette analyse, lâchée dans un moment d’honnêteté et… d’arrogance, est éclairante. On peut imaginer le désespoir des capitalistes et des hommes et femmes politiques du monde entier, s’arrachant les cheveux en l’entendant. Eux, qui passent leur temps à brouiller les pistes et à faire croire que la lutte de classes n’existe plus, que nous sommes tou·te·s uni·e·s dans une même nation, une même République. Et là, Buffet affirme que Marx avait raison ! Et bien, Marx avait effectivement raison et son analyse est toujours valable aujourd’hui.
Revenons d’abord sur certains éléments clés de celle-ci. Dès le premier chapitre du Manifeste du Parti communiste, écrit par Karl Marx et Friedrich Engels en 1848, la couleur est annoncée : « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire des luttes de classes. » S’ensuivent des passages sur la nature de cette lutte à travers les différentes phases de développement de la société humaine. Les auteurs rappellent non seulement la violence des exploiteurs (esclavagistes, féodaux ou capitalistes) à travers les âges mais aussi la résistance des exploité·e·s.
Plus tard, Engels précisera que par « l’histoire de toute société » il fallait comprendre « histoire écrite ». Car l’étude anthropologique de sociétés restées à l’écart du monde moderne permettait de déduire que dans les premières sociétés « primitives », les classes sociales n’existaient pas et que celles-ci n’émergeraient qu’avec la sédentarisation des tribus, la production d’un surplus de nourriture et son accaparement par une petite minorité.
C’est une remarque cruciale car si on pouvait dire que des sociétés humaines sans classes sociales (et donc égalitaires) avaient pu déjà exister, alors on pouvait très bien imaginer qu’un jour cela pourrait être de nouveau le cas.
Ruptures révolutionnaires
D’autre part, Marx et Engels ont montré comment, à certains moments de l’histoire, le mode de production d’une société (sa manière de produire les richesses) devenait un frein au développement de cette production. À ces moments-là, la contradiction est résolue de deux manières : soit par une révolution où la classe sociale émergente, porteuse d’un nouveau mode de production, renverse l’ancien régime qui bloque la société, soit par la défaite des deux classes et l’effondrement de la société dans son ensemble. Ainsi, en 1789 en France c’est la bourgeoisie révolutionnaire qui renverse la monarchie et la classe des seigneurs et qui ouvre la voie au développement de l’industrie, de la science et à une explosion des capacités de production.
Enfin, ils ont identifié des différences entre le capitalisme et les sociétés de classes précédentes qui sont d’une réelle importance pour nous aujourd’hui.
Pendant des siècles et jusqu’à l’avènement du capitalisme, la production des richesses est restée très faible. Il y avait à peine de quoi pouvoir nourrir tout le monde et la moindre sécheresse ou inondation pouvaient plonger des milliers, voire des millions de personnes dans la famine et la mort. Aujourd’hui nous pourrions nourrir plusieurs fois la population de la planète. Une société sans classe, socialiste, basée sur l’abondance est plus que possible, c’est-à-dire une société où il y aurait moyen de satisfaire les besoins de tou·te·s et pas seulement ceux d’une petite minorité.
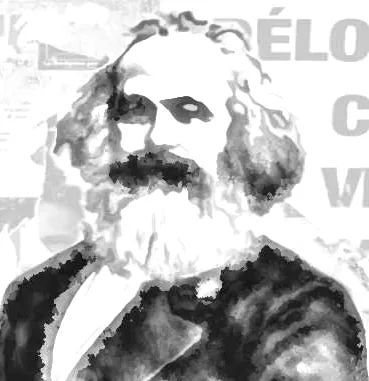
D’autre part, par le passé, les masses exploitées ont pris une place énorme dans les résistances et dans les changements de régime, comme dans la Révolution française où les paysans et les sans-culottes des villes ont joué un rôle primordial. Par contre, à chaque fois, c’est une nouvelle minorité qui a volé le pouvoir pour devenir une nouvelle classe dominante et… exploiteuse de ces mêmes masses populaires.
Nouvelle classe révolutionnaire
Avec le développement du capitalisme par contre, émerge une nouvelle classe sociale d’exploité·e·s, la classe ouvrière, qui n’est plus destinée à jouer les petites mains pour d’autres. Par son nombre, sa cohésion et ses capacités, elle a les forces d’être candidate à la prise du pouvoir pour son propre compte et à la reconstruction d’une nouvelle société pour le compte de tout le monde.
Enfin, dernière différence avec les modes de production précédents, le capitalisme s’accapare la planète entière. « Poussée par le besoin de débouchés toujours nouveaux [dit Marx dans le Manifeste], la bourgeoisie envahit le globe entier. » Et qui dit classe capitaliste exploiteuse mondiale, dit forcément classe exploitée (ouvrière) mondiale, c’est-à-dire des travailleur·euse·s qui ont les mêmes intérêts en commun et un même ennemi en commun à combattre. Si des luttes pouvaient démarrer dans des pays différents, la conclusion de Marx, dans le Manifeste, était que, « Dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils [les communistes]mettent en avant et font valoir les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le prolétariat ». Les travailleur·euse·s n’ont pas de patrie.
Et aujourd’hui ?
Ces analyses sont évidemment largement contestées par la droite et plus ou moins ouvertement par l’ensemble de la gauche, avec des arguments qui sont sans cesse relayés à l’école, à la télé et dans l’ensemble des médias. « Marx, c’est vieux », « la société a bien changé depuis, elle est bien plus complexe » et puis « la classe ouvrière n’existe plus ou du moins est aujourd’hui minoritaire » et que nous ferions de plus en plus partie d’une grande « classe moyenne ».
Comme preuve on nous renvoie souvent à la classification de l’INSEE. Comme brouillage des pistes on ne peut guère faire mieux. Pour commencer, on n’y parle non pas de classes mais de « catégories » sociales qui sont divisées en huit. On trouve effectivement des ouvriers (22 %) et des employés (8 %) mais pour les autres catégories tout est mélangé – les artisans avec les chefs d’entreprise, le clergé avec des instits et du personnel de santé (parmi les professions « intermédiaires » (13 %) mais pas avec des professeurs (de lycée ?) qui sont groupés avec les cadres (petits et grands) sans parler d’une grande catégorie où tout le monde se regroupe une fois la retraite venue (27 %), les « inactifs » (anciens ouvriers, cadres, chefs d’entreprise, agriculteurs, etc.
Il est clair que nous n’avons pas la même approche que les représentants de la sociologie bourgeoise, qui ne cherchent qu’à faire une simple photo figée de la société. En fait, rien n’est figé. Nous vivons dans un système dynamique qui permet à une petite minorité de capitalistes d’accaparer le fruit du travail d’une grande majorité de salarié·e·s. L’identification des classes sociales découle donc du rapport que les un·e·s et les autres entretiennent avec ce système d’exploitation et du rapport direct que les deux grandes classes sociales antagonistes entretiennent entre elles.
À partir de cette analyse, on peut conclure que la classe capitaliste (ou bourgeoise) ne constitue qu’à peine 1 % de la population, c’est-à-dire la classe qui détient ou gère et contrôle effectivement des capitaux. En face, la partie de la population qui, pour vivre, ne dépend que de sa force de travail, de son salaire et qui n’a absolument aucun contrôle sur le processus de production, sur les investissements, les embauches, les licenciements, etc. représente aujourd’hui au moins 80 %. Il est vrai que l’ancienne terminologie (« classe ouvrière ») peut porter à confusion, mais qu’on l’appelle « prolétariat », « nouvelle classe ouvrière » ou « classe des travailleur·euse·s », nous parlons bien d’une classe d’exploité·e·s majoritaires qui comprend aussi bien des salarié·e·s de l’industrie que des services.
Deux grandes classes
Comme l’affirmait Marx, nous vivons dans une époque où la société se décante de plus en plus en deux grandes classes opposées (bourgeoisie et prolétariat) mais comme du temps de Marx aussi, il existe des classes intermédiaires. Comme avant, il existe encore une classe moyenne (ou petite bourgeoisie) traditionnelle composée de petits paysan·ne·s, commerçant·e·s ainsi que des professions libérales comme architecte, médecin, avocat·e, notaire, etc. C’est une classe qui n’a pas les moyens de porter le projet d’un nouveau mode de production. Ainsi, dans les grandes batailles entre le capital et le travail, a-t-elle toujours fini par basculer d’un côté ou de l’autre. En période de grande mobilisations populaires et de perspective de victoires, voire de l’espoir de transformations sociales, une partie de cette classe moyenne peut rallier le camp des travaileur·euse·s. En période de défaite et de désespoir, la majorité de cette classe peut rallier la réaction.
À la différence de la période de Marx, une nouvelle classe moyenne a néanmoins émergé — salariée celle-ci — composée essentiellement de cadres mais pas du tout homogène. À un extrême, un·e PDG, salarié·e mais qui possède des stock-options et qui participe aux grands choix de l’entreprise, est de fait membre de la classe capitaliste. Le ou la petit·e cadre sans grande responsabilité, par contre est plus proche d’un·e travailleur·euse et, comme pour les membres de la petite bourgeoisie traditionnelle, iels peuvent osciller de la même façon entre les deux camps en fonction du rapport des forces.
Système mondial
D’autres changements sont également intervenus depuis 170 ans mais ne font que renforcer les analyses de Marx. À l’époque déjà, Marx identifiait la classe ouvrière comme une force montante porteuse d’un projet de transformation révolutionnaire de la société. Pourtant, à son époque le nombre d’ouvrier·e·s dans le monde entier était moins que dans la seule Corée du Sud d’aujourd’hui. En 2020, l’OIT estimait qu’il y avait 2 milliards d’ouvrier·e·s dans le monde sur un total de 3,3 milliards de salarié·e·s et qu’en 2015, 54 % de la population du monde vivait en ville.
Par ailleurs, nous avons vu que Marx a relevé qu’à certains moments dans l’histoire, un mode de production (esclavagistes ou féodal par exemple) devenait un frein à l’avancement de la société. Le conflit entre les classes qui représentaient le vieux et le nouveau monde pouvait se résoudre par une révolution ou par l’effondrement de toute la société. Au début du 20e siècle, la révolutionnaire Rosa Luxembourg parlait de « socialisme ou barbarie ». Depuis, nous avons pu assister aux pires de la barbarie : des famines dans un monde plein de richesses, deux guerres mondiales atroces, des régimes fascistes et un nombre incalculable de guerres régionales. Nous vivons aujourd’hui une époque où plane le spectre non seulement d’une nouvelle période de guerres et de fascisme, mais d’une catastrophe climatique qui pourrait aboutir non seulement à l’effondrement de la société mais à la fin de l’humanité toute entière.
En même temps, dans le monde entier les résistances au quotidien et les explosions de colère de notre camp n’ont jamais été aussi fortes. Et la France ne fait pas exception, que ce soit les grèves « invisibles » qui ont lieu tous les jours, l’immense mouvement des Gilets jaunes ou les millions en grève contre la réforme des retraites, sans parler de la vague « Me Too » ou de la révolte contre les violences policières.
Tous les feux sont au vert en ce qui concerne la possibilité et la nécessité d’une transformation révolutionnaire de la société, mais il reste la question brûlante de comment notre classe, pourtant majoritaire, pourra développer la conscience et les capacités nécessaires pour la réaliser.
Conscience de classe
C’est encore Marx qui pointe le premier cette question quand il parle de classe « en soi » et de classe « pour soi ». La classe « en soi », c’est tout ce qu’on vient de voir : la situation objective de la classe, son exploitation, son rapport aux exploiteurs, les intérêts objectifs partagés avec les autres membres de la classe, etc. La classe « pour soi » c’est la conscience de cette situation, et la confiance pour agir collectivement en défense de ses intérêts et pour mettre fin à sa situation d’exploité. Mais comment développer tout cela ? C’est un autre révolutionnaire, Antonio Gramsci, qui apportera des pistes, en partant de deux idées apparemment contradictoires de Marx. La première, « Les idées dominantes sont les idées de la classe dominante » (dans L’idéologie allemande, Karl Marx et Friedrich Engels) et la deuxième, « L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. » (Statuts de l’Association internationale des travailleurs dite 1re Internationale). Certaines idées dominantes sont le reflet de la manière dont le système fonctionne, comme l’existence de chefs ou la compétition (pour des notes, pour les concours, pour un boulot, etc.) et d’autres idées sont distillées régulièrement par les médias, comme le racisme, le sexisme ou l’homophobie dans le but de nous diviser… et cela fait bien sûr des dégâts énormes. Alors, si nous avons dans notre tête les idées dominantes, comment pourrions-nous nous émanciper nous-mêmes ? Le point de départ de la solution, c’est la lutte des classes. Car c’est la logique même du capitalisme, où chaque capital a besoin d’accumuler davantage que ses concurrents sous peine de disparaître, qui provoque sans cesse des résistances.

C’est dans ces moments de résistance à une exploitation toujours plus intense que des travailleur·euse·s peuvent se rendre compte que les idées dominantes ne sont d’aucune aide pour gagner. Au contraire, c’est la solidarité qui marche et non pas le chacun pour soi. C’est l’unité entre collègues blanc·he·s, noir·e·s, arabes, hommes, femmes, homos, hétéros, etc. qui permet de l’emporter, etc. C’est à ces moments qu’une nouvelle conscience (de classe !) peut émerger et peut se développer encore plus vite avec l’intervention de militant·e·s déjà conscient·e·s du besoin d’argumenter dans ce sens.
C’est vrai pour chaque petite lutte et encore plus pendant les périodes révolutionnaires. C’est Marx qui expliquait les deux raisons pour lesquelles une révolution est nécessaire. D’abord parce qu’il faut briser la résistance d’une classe dominante qui ne lâchera pas ses richesses et son pouvoir sans une lutte acharnée mais aussi parce qu’elle permet de débarrasser la tête de toutes les idées de merde accumulées depuis des années.
La bataille des idées
Dans ces moments de luttes inévitables, la bataille des idées est donc cruciale. La lutte des classes peut ouvrir la possibilité d’un changement rapide des idées et de la confiance mais rien n’est automatique. En face, tous les jours, la classe dominante mobilise ses experts, ses universitaires et ses idéologues dans les médias et ailleurs. De notre côté, il faudrait que nos syndicats soient de véritables « écoles de la lutte de classe » et que nos partis défendent nos intérêts de classe avec autant de détermination que leurs partis défendent les leurs. Malheureusement, les idées dominantes se répandent jusque dans la gauche syndicale et politique et la confusion qui s’ensuit contribue aussi, à certains moments, à « brouiller les pistes ».
Sans parler du PS, des Verts ou du PCF, même la partie la plus radicale de la gauche aujourd’hui, LFI, est loin d’être étrangère à ce phénomène.
Nous pouvons nous retrouver côte à côte avec des militant·e·s de LFI dans des grèves ou des manifestations. Mais les solutions qu’iels proposeront ne seront pas celles qui pourront renforcer la conscience de classe dans la perspective d’une autoémancipation mais seront celles qui détourneront la colère et l’énergie vers des élections et la délégation du pouvoir à une « nouvelle minorité » d’élu·e·s.
Ces derniers mois nous avons pu apprécier les positions courageuses de LFI sur la défense de la Palestine, malgré la violence des attaques dont elle a été l’objet. Elle est pourtant capable en même temps d’avoir des positions sur la défense de la nation française qui sont tout le contraire de l’internationalisme dont notre classe a besoin.
Quand des membres de LFI s’adressent à leur public avec un « chers compatriotes », quand on fait flotter le drapeau tricolore, qu’on fait chanter la Marseillaise, qu’on vante la puissance maritime de la France de par ses colonies, qu’on accepte le contrôle des frontières et la reconduite des débouté·e·s d’asile, alors on agit clairement contre les intérêts de notre classe.
L’ensemble des organisations de la gauche institutionnelle, politique et syndicale sème la confusion en essayant de combiner les notions de classe et de nation, de travailleur·euse et de citoyen·ne avec l’objectif de créer, au sein d’une société de classe, une République pour tou·te·s complètement illusoire.
Renouer avec Marx et la centralité de la lutte des classes
Pour notre part, nous sommes convaincu·e·s qu’il faut construire une organisation d’activistes capables d’intervenir pour construire les résistances et de proposer des stratégies pour unifier notre classe, pour faire gagner le mouvement et pour dresser des perspectives d’une auto-émancipation des travailleurs et du socialisme par en bas.

Cela signifie que dans la lutte de classe de tous les jours nous militons aussi contre toutes les oppressions qui peuvent nous affaiblir et nous diviser et en premier lieu le nationalisme et tous les racismes. Concrètement, pour commencer, cela veut dire une solidarité sans faille avec les migrant·e·s et les sans-papiers, et une bataille pour l’ouverture des frontières et la liberté pour qui le veut de s’installer sur le territoire français.
Nous avons commencé cet article par la citation de Warren Buffet, un vrai « guerrier de classe » qui, à l’époque, estimait que sa classe était en train de gagner. Pour nous, comme pour lui, nous ne faisons pas un simple constat de l’existence des classes sociales. Il s’agit bel et bien d’une lutte (voire d’une guerre, comme il dit). La seule différence est que nous devons faire en sorte qu’à la fin ce ne soit pas eux qui gagnent mais nous.





