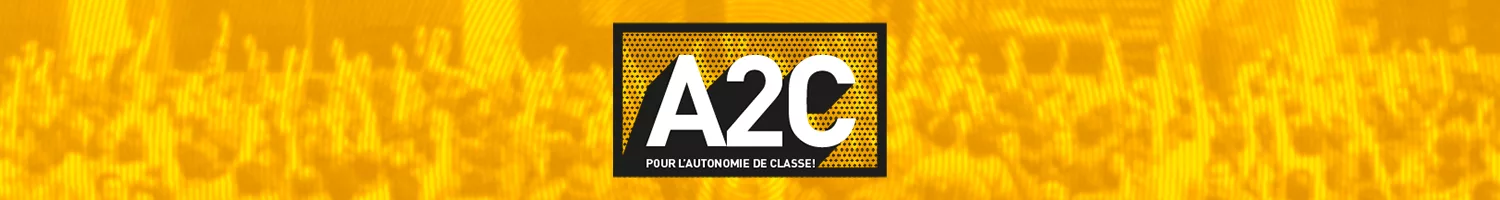Lors des mobilisations du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le mot d’ordre de “grève féministe” est partagé par les organisations féministes et par les directions syndicales.
Les Cahiers d’A2C #16 – mars 2025
D’un côté, la coordination féministe lance l’appel 8 mars 2025 : Grève féministe pour battre l’extrême droite1. Cette coordination rassemble principalement des collectifs féministes (dont le Collectif féministes révolutionnaires, la Relève féministe, Nous Toutes, etc…). De l’autre côté, les confédérations CGT, FSU, Solidaires, ainsi que les syndicats étudiants signent l’appel 8 mars 2025 : grève féministe !2. Ces deux appels sont lancés chaque année et mettent en avant l’idée d’une grève politique, l’arrêt du travail productif et du travail reproductif, même si ce dernier n’est pas explicitement nommé dans second appel.
Cette journée est préparée par une campagne de communication sur les réseaux sociaux, et dans la rue par des tracts et des affiches. Elle est également préparée par des formations. Par exemple, la CGT propose une journée de formation confédérale sur la Grève féministe le 11 février 2025, et un stage a été proposé l’an dernier sur ce sujet par l’intersyndicale du 93.
Le vendredi 8 mars 2024, des manifestations ont eu lieu dans plus de 200 villes, et 100 000 personnes ont manifesté à Paris. L’appel de l’intersyndicale à la grève a été suivi de préavis de grève sectoriels ou locaux : dans l’Éducation, à la SNCF, à Radio France et au CHU de Bordeaux. D’autres préavis de grève ont sûrement été déposés, mais il est difficile de les recenser car ils ne sont pas forcément rendus publics. Les grèves du travail productif semblent cependant ignorées dans milieu féministe. Quant à la grève du travail reproductif, on dirait qu’elle est inexistante en pratique.
Quels sont les obstacles à la construction de la grève féministe ?
Même si les appels nationaux à la grève féministe sont une réelle avancée, ce mot d’ordre n’est pas toujours suivi de grèves en pratique. Ou plutôt, il est suivi d’actions qui ne sont pas des grèves ! Le samedi 25 janvier 2025, la coordination féministe avait déjà appelé à une grève féministe contre l’extrême-droite. Cette mobilisation a donné lieu à une “nuit des collages” la veille, et à des conférences, des rassemblements ou des manifestations féministes le jour-même et le lendemain. On a l’impression qu’il suffit de dire “grève” pour que celle-ci advienne. Mais en réalité, pour citer Kim, une camarade d’Autonomie de Classe “La grève féministe n’est pas automatique”3.
On pourrait imaginer qu’il n’y a pas de grève féministe possible, sans syndicats féministes. L’outil syndical est essentiel pour construire des grèves économiques sur les lieux de travail (comme par exemple pour le respect de la loi du 23 mars 2006 sur l’égalité salariale), et l’enjeu est d’investir les syndicats pour construire une grève politique contre le patriarcat. Cependant, on remarque que les militant·e·s féministes s’investissent peu dans le syndicalisme. Ce qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs.
Premièrement, par une orientation politique qui prône l’autonomie des mouvements sociaux. Ainsi, le mouvement féministe devrait être autonome des syndicats et des partis. C’est une position qui est totalement justifiée pour éviter les instrumentalisations, voire l’hostilité qu’il y a pu avoir dans l’Histoire. Mais çe ne devrait pas décourager les militant·e·s féministes de s’engager dans le syndicalisme.
Deuxièmement, la composition sociale des organisations féministes n’est pas favorable à l’engagement syndical. Les collectifs féministes accueillent toutes les femmes et minorité de genre (voire les hommes dans les organisations mixtes). S’y investissent des travailleur·ses indépendant·e·s, des auto-entrepreneuses, des étudiant·e·s, des chômeur·ses, des retraité·e·s, des mères isolées… Et en ce qui concerne les femmes salariées, elles travaillent dans des entreprises ou administrations plus petites que celles où travaillent les hommes salariés. D’où une compréhension différente du syndicalisme. Comment voir le syndicalisme autrement que comme un obstacle, lorsqu’on milite dans une AG féministe qui ne rencontre les bureaucrates syndicaux seulement pour déclarer des manifestations ? lorsque le collectif ou la commission femmes de telle Union Départementale ne se réunit quasiment jamais ? lorsqu’il n’y a que des hommes dans la section syndicale de son lieu de travail ?
On constate donc que le mot d’ordre de “grève féministe” ne se traduit pas par des grèves effectives, ni par un engagement syndical pour construire celles-ci.
Quelles solutions peuvent apporter les révolutionnaires ?
Le matérialisme nous aide à analyser la situation, à considérer ce qui est matériellement existant, à comprendre d’où viennent les idées, et à changer le monde. Cette démarche nous oblige à lier la théorie à la pratique en construisant une grève effective. À nous poser concrètement les questions suivantes : Comment arrêter le travail productif ? Pourquoi les femmes salariées ne sont pas massivement en grève ? Comment arrêter le travail reproductif ? En faisant contribuer les hommes ? En socialisant les moyens de reproduction ?
La première étape serait de combattre les conceptions libérales et individuelles de la lutte féministe. Par exemple, Autonomie de Classe interroge la notion de “Premièr·e·s concerné·e·s” lorsque que cet argument empêche l’action ou la mobilisation. Cette question, en lien avec la non-mixité, est à repolitiser et à utiliser lorsque c’est nécessaire. On pourrait argumenter que tout le monde est moralement concerné·e·s par la lutte contre le sexisme, on ne peut être que choqué·e·s des féminicides, des viols, des agressions, du harcèlement… Les hommes salariés sont également matériellement concernés par cette lutte, parce que l’oppression des femmes et des minorités de genre sert de base au capitalisme. C’est ce que décrit la philosophe Silvia Federici en disant que le travail gratuit des femmes sert à reproduire la force de travail et donc le capitalisme lui-même4. Nous devons convaincre que l’unité de notre classe est la condition nécessaire à l’action collective, à la lutte politique pour renverser les oppressions et l’exploitation.
L’action collective ne doit être basée sur la construction d’un rapport de force, par une grève effective. Cela passe nécessairement par la reconstruction du syndicalisme. D’un syndicalisme comme un espace de solidarité directe entre les travailleur·ses. Notre confiance collective se mesurera par notre niveau d’organisation. La radicalité et la créativité du mouvement féministe ne peuvent que revitaliser les pratiques syndicales. En particulier, les révolutionnaires sont les mieux placé·e·s pour construire un syndicalisme militant qui fait le lien entre toutes les luttes, et qui s’engage dans la construction de grèves politiques.
En définitive, nous devons convaincre que la grève féministe doit gagner parce qu’elle nous fera avancer dans notre combat pour l’émancipation des travailleur·ses. Nous avons la construction d’une grève politique sous nos yeux ! Nous voyons bien que c’est une tâche qui prend des années, qui nécessite le développement d’une base théorique, de mots d’ordre radicaux, et de questionnements stratégiques et tactiques. Si la grève féministe réussit, alors elle pourra gagner sur ses revendications (l’égalité salariale, des investissements massifs dans les services publics, la gratuité des transitions de genre, le droit réel à l’IVG, etc…), et elle prouvera, en pratique et à tous·tes, que notre classe est capable de gagner, qu’elle fait tourner la société et qu’elle est capable de la changer. Cet exemple concret, par sa réussite, sera d’autant plus facile à reproduire pour construire une grève politique pour gagner la régularisation de tous·tes les sans-papiers, l’arrêt d’envoi de matériel militaire à Israël, l’arrêt des violences policières, et – pourquoi pas – le pouvoir des travailleur·euses.
Razac (Gironde)
- 8 mars 2025 : Grève féministe pour battre l’extrême droite sur le site de la coordination féministe ↩︎
- Appel à la grève féministe ↩︎
- Lire Kim, 2022, De la théorie à la pratique, la grève féministe n’est pas automatique, Les Cahiers d’A2C #02, en ligne sur notre site ↩︎
- Federici, Silvia. Le capitalisme patriarcal. Paris, La Fabrique Éditions. « Hors collection », (2019) ↩︎