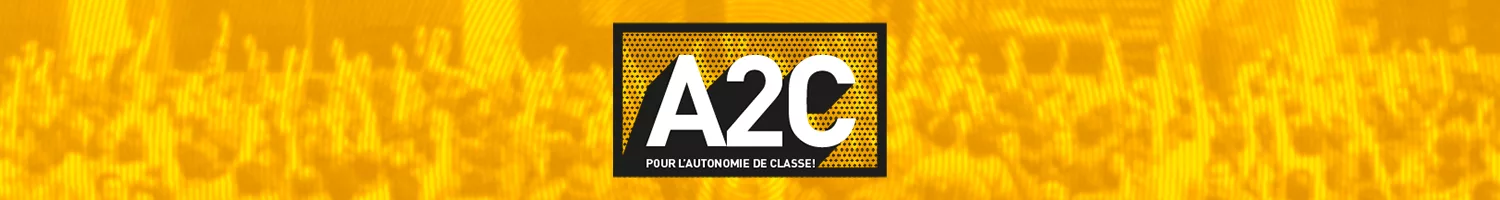La production et la consommation de drogue augmentent partout dans le monde. La concurrence exacerbée au sein du marché mondial de la drogue est exacerbée. La régulation de la concurrence se fait, en dernier recours, par l’usage d’armes pour impressionner voire éliminer des concurrents.
Dans ce contexte, un débat a lieu parmi les associations et collectifs dont nous faisons partie à Rennes. Que faire face à ces violences qui touchent bien au-delà des seuls travailleurs de l’industrie de la drogue ? Cette situation amène à se pencher sur les raisons de ces violences, les réactions de notre classe, celles des dominants, et enfin sur des pistes pour éviter le pire.
Augmentation des cas de tirs dans nos quartiers
Après le quartier du Blosne à l’été 2023, c’est au tour de Villejean-Kennedy d’être décrié tel une zone de non-droit. Depuis plusieurs mois, les violences liées à la drogue ont augmenté dans nos quartiers. En janvier de cette année, des échanges de tirs ont eu lieu sur la dalle Kennedy au rythme d’une à deux fois par semaine. Entre septembre 2024 et janvier 2025 à Rennes, 5 personnes ont été tuées par arme blanche. Ces actes ne sont pas toujours le fruit des mêmes tensions, et surtout, en fonction de l’usage ou non d’armes à feu, les réactions au sein de notre classe ne sont pas les mêmes. Pour pouvoir en débattre sereinement, nous voulons essayer d’éviter les tabous et les fantasmes, comme pour l’approche d’autres questions, par exemple sur l’usage des armes dans la lutte révolutionnaire. Ce qui fait principalement peur, et qui est à l’origine de réactions plus vives, c’est l’utilisation d’armes à feu, alors qu’il n’y a pas eu de mort du fait de leur utilisation.
1. Les raisons des violences liées au commerce de la drogue
Pour appréhender les violences qui ont lieu dans nos quartiers et espérer vraiment qu’elles disparaissent, il est crucial de comprendre où elles prennent leurs racines. D’un point de vue global, on peut dire que l’usage de la violence existe dans tout marché, même lorsqu’un produit est licite. Elle ne s’exprime pas toujours par les armes. Par ailleurs, les guerres sont des affrontements d’intérêts capitalistes perçus comme légitimes car menés par des Etats ou des milices qui cachent mal leur volonté de gagner des marchés à l’échelle mondiale ou de rester dans la course. On peut notamment citer le cas du cobalt et du coltan dans l’est de la République démocratique du Congo, les microprocesseurs dans la nouvelle guerre froide entre la Chine et les Etats-Unis, l’or, les armes, le pétrole… Les drogues ne font exception que par leur caractère illégal dans de nombreux pays, ce qui induit une régulation du marché par ses propres acteurs.
Quand l’ensemble du territoire est couvert par la distribution d’un produit, le marché se tend. Les politiques en termes de prix deviennent agressives, il faut vendre plus, plus vite, en coupant le produit, en alléchant les consommateurs. Il y a systématiquement une tension sur le marché mais elle ne s’exprime pas de la même manière selon les secteurs. Reprendre la main sur les débouchés d’un concurrent est finalement un objectif classique de tout patron dans le système capitaliste. Il en va de même pour le commerce de la drogue. Même si les raisons sont multiples, l’usage des armes peut être une illustration spectaculaire de la concurrence. Certains travailleurs du bas de l’échelle sont payés pour faire usage des armes à feu.
Si de plus en plus de personnes, et de plus en plus jeunes, sont amenées à travailler dans le marché des drogues, c’est avant tout du fait du capitalisme et du racisme qui empêchent une frange importante des jeunes prolétaires, en particulier Noir·es, Arabes, ou considéré·es tels, d’accéder à des emplois stables et décemment rémunérés. L’ostracisation et la misère dans lesquelles vit une grande partie de la jeunesse aujourd’hui, et notamment les jeunesses noire et arabe, pousse celles-ci à chercher un travail pour lequel il n’y a pas besoin de papiers français, de diplômes ou d’avoir un niveau de français B2. En plus d’être un marché particulièrement traversé par l’usage des armes, les conditions de travail sont très difficiles (froid, attente, stress, risque d’arrestation, de blessure, mépris d’une grande partie de la population…) et il n’y a aucune protection (pas de cotisations, donc pas de retraite ou d’arrêt maladie, pas de revenus déclarés donc accès difficile au logement et aux droits sociaux).
Des violences surtout subies par les jeunes vendeurs…
La situation à Kennedy est aussi exemplaire de ce que sont les conditions de circulation de la drogue aujourd’hui. Les vendeurs sont en grande majorité des jeunes adultes ou des mineurs. A Rennes, la plupart des personnes qui ont usé d’armes ou en sont mortes ces derniers mois ont autour de 20 ans. La hiérarchie leur demande des missions nécessitant l’usage d’armes dont ils ne savent pas se servir, mais la pression pour la réalisation des missions est forte et la paie peut paraître intéressante si on exclut la menace de mort au travail. A Rennes en tous cas, les balles blessent leur cibles, les tuent rarement, et font également des victimes collatérales parmi les habitant·es du quartier qui n’ont rien à voir avec le trafic ou sont les familles de vendeurs. Nous pouvons aussi considérer que les personnes qui ne sont pas touchées par les balles sont également des victimes psychologiques. Bref, il n’y a pas à relativiser l’effet néfaste de l’usage d’armes. Pour autant, il nous faut comprendre d’où vient leur utilisation et admettre que dans tous les cas, c’est notre classe qui trinque pendant que les bourgeois se sentent au chaud et en sécurité dans leurs ghettos.
…dans un contexte d’augmentation de la demande et de la concurrence
Tout comme pour la vente, il peut être pertinent d’interroger l’origine de la consommation de drogue pour éviter d’en avoir une approche morale, jugeante et suffisante. Le marché de la drogue répond à une demande de plus en plus forte dans la population. Par exemple, le dernier rapport de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) a révélé qu’un million de français·es ont consommé de la cocaïne en 2023, presque le double de l’année 20221. Pour l’ensemble des drogues les plus populaires, les client·es ont des profils divers. Les consommations n’ont presque aucune limite de temps ni d’espace. La consommation dans le cadre du travail se répand pour maintenir les cadences infernales voulues par le capitalisme ou contrer l’ennui de jobs inutiles2. Les drogues vendues sont de plus en plus nombreuses et elles correspondent à des usages multiples, le principal restant l’usage récréatif. Dans cet article, nous avons fait le choix de nous pencher surtout sur l’aspect répressif, mais la question de la consommation et celle des addictions – car il faut bien distinguer les deux – et des dangers pour la santé du marché de la drogue, pourra faire l’objet d’un article futur3.
2. Des réponses de notre classe
Se retrouver dans l’espace public
Face aux situations de violences, diverses réactions d’habitant·es ont lieu, et ressemblent à ce qui s’entend et se voit dans d’autres villes, notamment à Marseille. L’une d’elles est l’appel à se rassembler dans l’espace public, justement là où des coups de feu ont été échangés. Au Blosne, en mai 2024, l’association Avenir a organisé un repas avec 200 personnes du quartier pour recréer du lien, sur la place du Banat où avait eu lieu de longs échanges de tirs deux mois auparavant. A Kennedy en janvier 2025, c’est un collectif d’habitant·es du quartier, Kune, qui a appelé par deux fois à des rassemblements.
Plus de sécurité ?
Cette première réponse de notre classe, lancée à quelques mois d’intervalle dans les deux quartiers, permet la (re)création de liens, d’échanger autour des faits, de la peur, et amène rapidement le sujet de la sécurité sur la table. A Kennedy, le rassemblement avait dès le départ pour mot d’ordre la “sécurité de nos enfants” face au risque et à la peur des balles perdues notamment. En plus de se rendre visible et de rendre visible leurs inquiétudes dans l’espace public, qui est partagé par une diversité de personnes ayant différents rapports avec la vente de drogue et la violence qui lui est associée, le collectif avait aussi pour but avec ces rassemblements de réclamer à la mairie la remise en service des caméras de surveillance (détruites pendant les révoltes suite à l’assassinat de Nahël en protestation contre les violences policières) et l’augmentation des effectifs de la police de proximité (aka police municipale).
Le sentiment d’impuissance
Cette situation récente n’est pas un cas isolé et elle se reproduit partout où il y a des violences de ce type. Elle montre bien comment le sentiment d’impuissance face aux violences armées qui déchirent les quartiers favorise la délégation à l’État et la police. Même des personnes spontanément contre les réponses sécuritaires et racistes, en voyant l’ampleur de la violence, s’en remettent à l’Etat ou aux institutions en réclamant des mesures souvent perçues comme moins dommageables pour les populations des quartiers, comme l’augmentation des forces de police de proximité qui, comparée à des compagnies de CRS armées de mitraillettes, semble souvent être une solution intermédiaire.
3. La réponse d’en haut
La réponse étatique à la situation est évidemment celle de la répression, de la violence institutionnelle. En novembre 2024, Bruno Retailleau s’est déplacé personnellement pour “rassurer les habitant·es” de Maurepas, un autre quartier de Rennes en prise avec la violence armée. A Kennedy depuis novembre, la présence policière est permanente. Avec au début une voiture de police postée sur la dalle pour l’observer toute la journée, tout le mois de janvier, c’étaient des dizaines de camions de CRS dans le quartier, des patrouilles de flics arborant des armes chaque semaine, des fouilles d’immeubles.
La répression renforce le racisme
Dans un entretien donné à Blast4, Fabrice Olivet, un des cofondateurs de l’ASUD (Auto Support et prévention du VIH parmi les Usagers de Drogues) revient sur la fonction politique de la répression de la drogue, avec un exemple états-unien. Ne sachant plus comment endiguer le mouvement pour les droits civiques et le mouvement anti-guerre à la fin des années 1960 – mouvements qui allaient à l’encontre des ambitions impérialistes, le gouvernement a utilisé une tactique de contournement du problème. Après avoir pris le temps d’associer les populations noires-américaines à la consommation d’héroïne et les hippies anti-guerre à celle de cannabis dans la presse et les instruments de propagande étatique, le gouvernement de Nixon, comme le confirmera bien plus tard un de ses proches conseillers de l’époque5, a criminalisé ces deux consommations. Cela lui a permis de réprimer les communautés noires-américaines et pacifistes très durement, en perpétrant des arrestations arbitraires, des perquisitions, des interdictions de réunions sous prétexte de la lutte contre le trafic. L’impact a été puissant.
En France, l’Etat et ses institutions utilisent le prétexte de la lutte contre le trafic de drogue pour exercer une présence policière forte dans les quartiers de prolétaires et notamment racisés, pour intimider leurs habitant·es, et au final exercer un contrôle social tout en pointant du doigt l’ennemi intérieur. Les médias et les politicien·nes, surtout de droite et d’extrême droite, mais parfois aussi de gauche, mettent aussi les violences liées au trafic en avant, stigmatisant ainsi les quartiers populaires et leurs habitant·es.
Ce racisme s’exprime, sous couvert d’enjeu sanitaire ou de sécurité, depuis des dizaines d’années : de la qualification des vendeurs de drogue de “racailles” dont il faut “se débarrasser” par Sarkozy en 2005 à Retailleau et son néologisme des “narcoracailles” en 2025, en passant par Darmanin comparant la lutte contre le trafic à une “guerre”…
A Kennedy depuis des semaines, ce sont des fouilles au corps par dizaines, des interpellations parfois violentes, des perquisitions dans les commerces mais seulement ceux gérés par des arabes, des régiments de CRS, des fouilles d’immeubles, et de plus en plus, la présence de la Police Aux Frontières (PAF), qui arrête et enferment des personnes sans papiers français dans les CRA6. En plus de violenter les personnes noires et arabes, de semer la peur dans le quartier, de mettre au pas la population, ces opérations servent à nous trier en contrôlant les jeunes hommes racisés pour traquer les personnes sans-papiers.
Le lien clair entre la répression de la drogue et le racisme d’État est également visible dans les réactions médiatiques lorsque de telles opérations ont lieu. En effet, il n’est pas rare que les médias d’extrême-droite comme BFMTV et CNews s’empressent de faire des reportages dans les quartiers et d’interroger les habitant.es sur leur sentiment d’insécurité lors de celles-ci. Ils donnent évidemment la parole à des personnes qui argumentent pour plus de police et soulignent les origines des jeunes vendeurs si cela permet de renforcer l’amalgame entre immigration et délinquance. Pour les fascistes, l’intérêt pour la sécurité des habitant·es du quartier existe simplement pour construire le “eux” et le “nous”. Dans un Etat raciste, attiser la répression, c’est faire le jeu du racisme.
L’échec de la répression
En plus d’être un prétexte pour perpétrer des violences sociales racistes, la stratégie répressive a montré par bien des fois qu’elle reste constamment un échec pour traiter le problème de la violence liée au trafic de drogue. La présence policière accrue dans les quartiers a au contraire généralement l’effet inverse, celui d’une escalade de la violence. Plus les dealers sont traqués sur leur territoire, plus ils font face à une répression violente qui menace leurs revenus et leur liberté de circuler, plus la tension augmente et plus les affrontements se font fréquents et violents. Quand aux balles du trafic (qui arrivent après bien d’autres échelles de conflit comme des bastons ou l’utilisation d’armes blanches) s’ajoutent les balles de la police, la situation ne peut que dégénérer. Et nous savons tous·tes ce que fait la police quand elle intervient dans les quartiers populaires : elle tue.
En plus d’échouer à faire redescendre les tensions et la violence, les politiques répressives contre la drogue échouent à faire diminuer la consommation et les risques sanitaires qui y sont liés. Comme l’a montré notamment la prohibition aux Etats-Unis, ou encore la criminalisation de l’avortement, les raves party, interdire une pratique par un arsenal législatif et juridique ne signifie en rien l’éradiquer, mais seulement la rendre plus dangereuse. Comme le raconte Fabrice Olivet, en France dans les années 80, les services de santé publique ont interdit l’achat libre de seringues en pharmacie, avec pour but la diminution de l’utilisation de celles-ci pour consommer des drogues injectables. Cela a eu pour seul effet de faire exploser les cas de VIH dans les quartiers et de permettre l’avancement de l’épidémie, les consommateur·ices se partageant les seringues.
4. Pistes pour faire autrement
Que faire de nos inquiétudes ? Comment réagir sans faire appel à l’État ni à la police ?
Identifier notre camp
Il est primordial de reconsidérer les travailleurs-ses de la drogue comme des membres de notre classe, qui sont obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins. Certes d’une manière qui affecte directement le quotidien ou l’espace de vie d’autres personnes. Mais il faut retrouver le lien qui nous unit en tant que classe au-delà du simple jugement des individus qui recherchent une voie vers l’émancipation économique en dehors des sentiers classiques, par choix ou plus souvent, par obligation.
(Re)faire classe
Les deux collectifs Avenir et Kune ont eu une bonne réaction en appelant à se réunir à l’extérieur lors de rassemblements, de discussions, de repas collectifs. Que ce soit lors de ces événements ou de manière plus intimiste, il faut inviter les vendeurs de drogue à discuter de leurs conditions de travail, de leurs galères, de leurs peurs aussi. Il faut du temps aussi pour créer de la confiance. Mais cette confiance ne viendra certainement pas si on revendique plus de police.
Tisser des réseaux de solidarité
Pour régler nos problèmes, il nous faut des espaces de dialogue dans le quartier, des institutions de notre classe, des rituels, des réflexes, des liens, des espaces où régler les problèmes entre habitant·es, créer du lien. Si la police vient et commet des violences policières : revendications claires contre le racisme, contre les fouilles intempestives, contre la présence policière permanente et le contrôle social, empêcher la police de rentrer dans les immeubles, questionner les keufs quand ils emmerdent les gens sur la dalle, etc.
Viser la fin du capitalisme
A court terme, sachant que les taux de chômage continuent d’être forts, que les discriminations sctructurelles racistes se perpétuent et que la machine à fabriquer des sans-papiers se renforce, disons-le directement : militer pour un meilleur accès à l’emploi stable et décemment rémunéré est une douce illusion. Autant être honnêtes et viser le plus raisonnable : la fin de l’exploitation, du racisme et du capitalisme.
Dès aujourd’hui, construisons les dates du 20 mars (journée internationale contre les violences policières), du 22 mars (journée internationale contre le racisme) et la campagne Abolish Frontex, qui aura lieu en loin dans plusieurs pays du monde.
Ju Le Moal et Solen Febe (Rennes)
- Voir les chiffres sur le site de l’OFDT : https://www.ofdt.fr/ ↩︎
- https://tinyurl.com/cocaine-au-travail-2023 ↩︎
- A ce propos, lire la brochure écrite par Michael Cetewayo Tabor, ancien addict et membre du Black Panther Party (1969). Lire en ligne sur https://enquetecritique.org/projets/capitalisme-came-genocide/article/capitalisme-came-genocide-les-brochures ↩︎
- https://linkcuts.org/Blast_Drogue ↩︎
- “L’équipe de campagne de Nixon en 1968, et la Maison blanche par la suite, avaient deux ennemis : la gauche pacifiste et les noirs. (…) Nous savions que nous ne pouvions pas rendre illégal le fait d’être pacifiste ou noir, mais en incitant le grand public à associer les hippies à la marijuana et les Noirs à l’héroïne, puis en criminalisant lourdement les deux produits, nous pouvions casser ces communautés. On pouvat arrêter leurs responsables, fouiller leurs maisons, briser leurs rassemblements et les diaboliser jour après jour dans les JT. Est-ce qu’on savait qu’on mentait à propos des drogues ? Bien évidemment.” Source : https://harpers.org/archive/2016/04/legalize-it-all/ ↩︎
- https://tinyurl.com/Place-nette-XXL-Nantes ↩︎